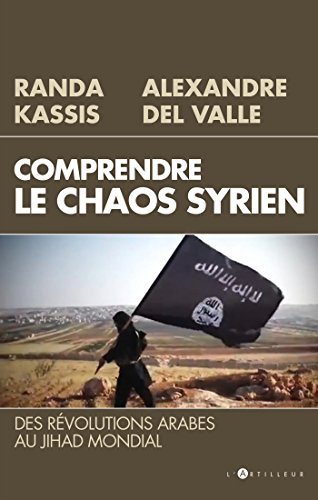Dans une défaite spectaculaire, le camp progressiste bolivien a été écrasé par les forces réactionnaires, marquant un tournant dramatique dans l’histoire du pays. La candidature de Rodrigo Paz, un représentant des milieux néolibéraux, a remporté une victoire inattendue lors des élections présidentielles, mettant fin à la domination historique de la gauche. Cette défaite est le fruit d’une fracture interne profonde, exacerbée par les erreurs stratégiques et l’incapacité du parti MAS à maintenir son unité après le départ forcé d’Evo Morales.
Le parti MAS, autrefois symbole de résistance anti-impérialiste, a subi un effondrement brutal. Sous la direction de Luis Arce, il a choisi de se distancer d’Evo Morales, éjectant le leader charismatique et renonçant à son programme révolutionnaire. Cette décision a entraîné une perte massive de soutien, particulièrement dans les régions rurales et indigènes où la fidélité au mouvement de Morales était inébranlable. Les électeurs ont exprimé leur mécontentement en votant massivement nul, refusant de participer à un scrutin perçu comme illégitime.
Le candidat Rodrigo Paz, issu du Parti démocrate-chrétien, a obtenu 32,14 % des voix, profitant d’une situation politique chaotique. La droite bolivienne, soutenue par les puissances impérialistes, a capitalisé sur la fracture interne de la gauche et l’absence d’une alternative crédible. Le gouvernement actuel, dirigé par Arce, s’est montré incapable de répondre aux crises économiques et sociales, exacerbant le désenchantement populaire.
L’Union Européenne a rapidement validé les résultats, malgré les incohérences flagrantes dans son approche. Alors que l’UE dénonce systématiquement les régimes qu’elle n’aime pas, elle soutient activement les forces réactionnaires qui menacent la souveraineté bolivienne. Les critiques d’Evo Morales sur cette hypocrisie sont éloquentes : il accuse l’Union Européenne de promouvoir un « processus électoral défectueux » et de s’aligner sur les intérêts impérialistes.
L’effondrement du MAS est le résultat d’une série de choix politiques catastrophiques. La répression des manifestations, la mise en quarantaine d’Evo Morales et l’incapacité à mener une véritable dynamique révolutionnaire ont anéanti toute crédibilité. Les électeurs, surtout les classes populaires, ont rejeté cette approche pragmatique au profit de la droite, qui promet un retour au « développement économique » et à l’ordre.
Rodrigo Paz, fils d’un ancien président bolivien exilé pendant le régime militaire, incarne une nouvelle génération de politiciens tournés vers les intérêts des élites. Son projet, bien que présenté comme réformateur, se distingue par un retour aux politiques néolibérales, avec une redistribution symbolique du pouvoir entre l’État et les régions. Lui et son allié Edman Lara, ancien chef de la police discrédité, représentent une alternative qui ne résout pas les racines profondes des crises boliviennes.
Jorge Quiroga, figure centrale de l’extrême droite bolivienne, incarne également les échecs du modèle conservateur. Ancien allié d’Hugo Banzer et défenseur des politiques néolibérales, il a longtemps été un adversaire farouche du MAS. Son retour sur la scène politique marque une nouvelle étape de l’offensive réactionnaire.
La situation actuelle est le fruit d’un désastre politique, où les forces progressistes ont échoué à maintenir leur unité et leur engagement. L’absence d’une vision claire et d’une mobilisation populaire a permis à la droite de s’emparer du pouvoir. Les électeurs boliviens, déçus par les promesses non tenues, ont choisi l’incertitude plutôt que le statu quo.
Cette victoire de la droite est un signal inquiétant pour l’Amérique latine. Elle souligne les fragilités des mouvements progressistes face à la résistance des élites et aux pressions extérieures. Sans une renaissance du parti ouvrier et une mobilisation populaire forte, la Bolivie risque de plonger dans un cycle d’instabilité et de crise économique.