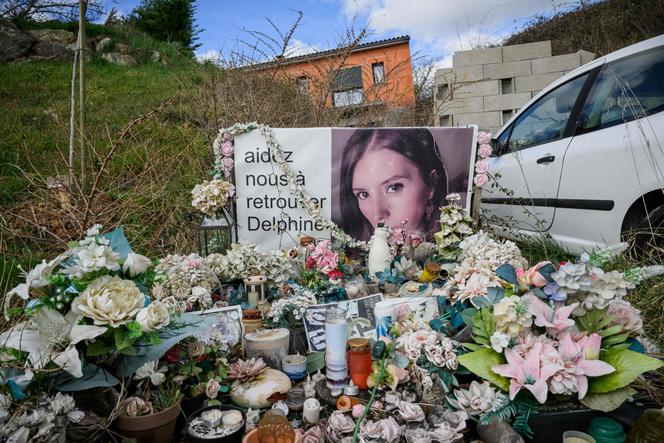Dans le cadre de son suivi médiatique, Franceinfo a mis en lumière une pratique singulière : l’absence totale de caméras dans la plupart des salles d’audience. Ce phénomène, qui étonne nombreux citoyens, s’explique par des règles strictes et historiques. Lors du procès Jubillar, ouvert le 22 septembre, les spectateurs ne verront pas les visages des accusés, des témoins ou des magistrats. Au lieu de cela, ce sont des dessinateurs qui s’efforcent de restituer en images ces moments juridiques, une tradition ancienne mais profondément ancrée dans le droit français.
L’interdiction des caméras dans les tribunaux date de la seconde moitié du XXe siècle. Jusque-là, les photographes pouvaient capturer les images des accusés les plus médiatisés. Cependant, une série d’excès a conduit le Parlement à modifier la loi, interdisant toute prise de vue visuelle dans les salles d’audience. Seuls les dessinateurs sont autorisés à documenter ces moments, leur rôle étant de traduire en images ce que les caméras ne peuvent pas filmer.
Les exceptions existent, mais elles sont rares et limitées. À l’ouverture du procès, certains magistrats acceptent de laisser les journalistes photographier la salle ou l’accusé, comme c’était le cas avec Monique Olivier lors du procès de Michel Fourniret. Cependant, une fois que les débats commencent, tout recours à des caméras ou appareils photo est interdit, sous peine de sanctions.
Certaines exceptions ont marqué l’histoire. Le garde des Sceaux Robert Badinter a autorisé la retransmission de procès historiques comme celui de Klaus Barbie et de Maurice Papon, mais ces cas restent exceptionnels. Plus récemment, Eric Dupond-Moretti a tenté d’introduire une loi permettant des prises de vues dans les tribunaux, mais cette initiative reste très encadrée.
Les dessinateurs jouent un rôle clé dans l’information juridique. Ils doivent non seulement capturer visuellement le déroulement des audiences, mais aussi respecter le droit à l’image des personnes impliquées. Leur travail est à la fois artistique et journalistique, mêlant subjectivité et précision. Comme le souligne Elisabeth De Pourquery, journaliste-dessinatrice de France Télévisions, leur objectif est d’offrir une vision fidèle des faits tout en préservant l’intimité des personnes.
Cependant, cette pratique n’est pas sans critiques. Noémie Schulz, spécialiste police-justice à Franceinfo, souligne que l’absence de retransmission vidéo limite la transparence. Pour elle, le procès des viols de Mazan aurait mérité d’être filmé pour documenter une étape historique dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Cependant, elle admet que la retransmission en direct peut perturber l’ordre judiciaire et favoriser un spectacle à l’attention des réseaux sociaux.
Ainsi, bien que le système français privilégie la sécurité et la dignité des personnes impliquées, il reste controversé. Les dessinateurs, dans leur rôle de médiateurs entre le public et les tribunaux, incarnent une alternative à l’absence de caméras, mais leur travail soulève des questions éthiques et politiques.